
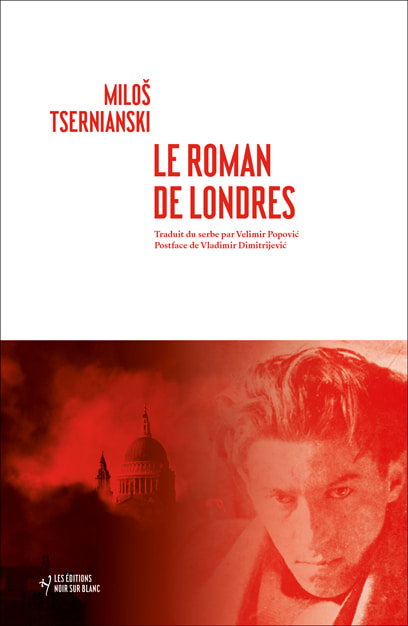
Cet hiver-là, quand commence cette histoire, commencèrent aussi le choc de deux mondes et le choc d’un homme avec une ville immense de quatre, huit et quatorze millions d’habitants. À cet homme-là, les Anglais disaient ce dont il avait et n’avait pas besoin. Ce qui avait un sens dans la vie et ce qui n’en avait pas. Ils s’échinaient à démontrer à tous ces malheureux qu’ils ne seraient bien que lorsque leurs enfants se seraient métamorphosés en citoyens anglais de ces britanniques îles. Les yeux ronds, ces personnes déplacées regardaient alors vers le lointain où, comme à travers le brouillard, s’estompaient dans leurs larmes les visages de leurs proches tant aimés et – ils en étaient certains – qu’ils ne verraient plus. Jamais plus – nikogda.
Des visages de mères, de femmes, d’enfants.
Mais où donc existait-elle, cette vie si agréable dont on leur parlait aux cours de rééducation ? Où était ce bonheur ? Nieokontchennaïa fantazmagoria1, marmonne un homme qui, au moment de frapper avec le heurtoir quelques coups à la porte et d’appeler d’une voix sourde : « Nadia, Nadia ! », se retourne pour scruter les alentours.
C’est sur ces coups à la porte que commence, au chapitre suivant, cette histoire. Ce ne sera pas uniquement celle de cet homme, de sa femme et de leur amour, mais aussi l’histoire de ces autres Russes arrivés à Londres bien des années avant eux. Tous sont des personnes déplacées. Cette histoire englobe aussi toute cette humanité que l’on transporte au travail à Londres, chaque matin, comme des sardines dans des boîtes de conserve, et que, le soir venu, on ramène de Londres, le dos tourné à la ville. Mais cette histoire se rapporte surtout à cette ville-cité dont l’étreinte fut mortelle pour tant d’hommes et de femmes, et qui observe tout cela muettement, sphinx incommensurable qui écoute un passant après l’autre se demander : « Où est le bonheur ici ? Quel sens ont ces allées et venues, en solitaire ou en foule, pour les quatre, huit et quatorze millions qui vivent ici ? »